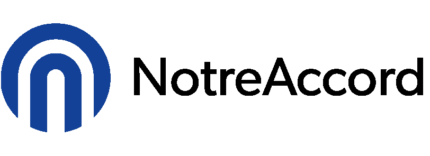RPS : nouvelle jurisprudence, nouvelles chances d’adopter la politique de l’amiable.
L’année 2025 est marquée notamment par deux décisions de la Cour de Cassation qui renforcent l’exigence de vigilance des employeurs face aux risques psychosociaux (RPS).
Dans un contexte où la santé mentale (des salariés) érigée en cause nationale pour 2025 par le gouvernement et le bien-être au travail deviennent des leviers clés d’attractivité pour une entreprise par le renforcement de la marque employeur, la politique de l’amiable s’impose comme un atout majeur pour les organisations.
La médiation, un outil stratégique pour l’équilibre d’une organisation ?
L’arrêt du 21 janvier 2025 (chambre criminelle, N°22-87.145) précise que le harcèlement moral institutionnel, c’est-à-dire issu d’une politique d’entreprise, est pénalement sanctionnable, même sans victime directement identifiée.
Les dirigeants peuvent être tenus personnellement responsables lorsqu’ils ont participé à la conception ou à la mise en œuvre d’une politique managériale dégradant les conditions de travail.
L’arrêt du 6 mai 2025 (chambre sociale, N°23-14.492) indique que la persistance d’un management toxique, malgré un avertissement, peut caractériser une faute grave justifiant le licenciement d’un cadre dirigeant.
L’employeur reste tenu d’une obligation de sécurité, mais cela n’exonère pas le salarié de ses propres responsabilités.
Ces arrêts convergent : la justice considère désormais que les pratiques de management elles-mêmes, et pas uniquement des comportements individuels isolés, peuvent caractériser le délit de harcèlement.
Pourquoi ces décisions sont-elles importantes pour les entreprises ?
Les employeurs ne peuvent plus considérer que seule une faute individuelle engage leur responsabilité.
Désormais, c’est aussi la conception et l’organisation du travail qui sont scrutées par les juges.
Ces arrêts rappellent que l’employeur doit mettre en place de véritables politiques de prévention des RPS, au risque d’une condamnation lourde.
Au-delà de la responsabilité pénale, ces jurisprudences ouvrent la voie à une mise en cause pour faute inexcusable de l’employeur si celui-ci :
- ne prend pas les mesures de prévention nécessaires ;
- laisse perdurer des pratiques de management délétères pouvant aboutir à la reconnaissance d’un accident du travail ou une maladie professionnelle (système complémentaire des affections hors tableaux), préalable à la mise en cause de l’employeur pour faute inexcusable ;
- ou omet de diligenter des enquêtes internes et de mettre en place des dispositifs de soutien adaptés.
La faute inexcusable, rappelons-le, entraîne des conséquences lourdes : majoration de la rente accident du travail/maladie professionnelle, indemnisation complémentaire des victimes, voire mise en cause de la responsabilité pénale des dirigeants.
Les managers de proximité comme les cadres dirigeants peuvent voir leur responsabilité personnelle engagée, y compris lorsqu’ils appliquent une politique décidée par la direction.
L’enjeu d’image et de performance de l’entreprise est en cause : au-delà du risque juridique et financier, une politique de management perçue comme toxique dégrade la marque employeur, accroît le turnover et impacte la productivité.
La médiation organisationnelle, un outil novateur de prévention des RPS.
Les RPS regroupent l’ensemble des risques liés :
- au stress chronique (pressions excessives, surcharge, objectifs irréalistes) ;
- au manque de reconnaissance ou de soutien ;
- aux tensions interpersonnelles ou conflits d’équipe ;
- aux changements organisationnels brutaux (fusion, réorganisation, télétravail mal encadré) ;
- au management toxique ou autoritaire.
Or, ces facteurs ne relèvent pas uniquement de la santé au travail ou de la médecine du travail. Ils sont profondément liés à la qualité du dialogue social et organisationnel.
Alors, qu’entendons-nous par médiation organisationnelle ?
Il ne s’agit pas (seulement) de la résolution d’un conflit déjà déclaré entre collaborateurs, équipes, instances dirigeantes, mais d’une démarche globale qui s’attache aux modes de management, aux processus internes, aux relations collectives, aux signaux faibles.
Elle se déploie en prévention (plutôt qu’en réaction) et concerne les ambiances de travail, le climat de justice organisationnelle, notamment.
Elle complète la médiation interpersonnelle en visant une dimension systémique, de préférence en amont de tous contextes conflictuels. Elle marque une volonté affirmée du dirigeant de regarder son organisation avec d’autres lunettes, dotées d’une correction plus nette sur la vérité des rapports sociaux.
Ce mécanisme permet d’une part, de repérer les signaux faibles avant qu’ils ne surviennent ou ne s’aggravent et d’autre part, d’agir sur des sujets précis et redoutés des entreprises, par exemples un turnover élevé, un absentéisme fort, des plaintes anonymes ou des conflits latents.
S’intéresser au ressenti des salariés dans des contextes de transformation, de rapprochement d’entreprises, de services, parfois effrayant, en amont des accompagnements de conduite du changement révèle une volonté du dirigeant de rencontrer la « vérité terrain » de son organisation.
Il est important de souligner que l’engagement de la direction dans la mise en œuvre d’un tel dispositif n’est efficace que s’il est authentique, assertif et congruent.
Cette démarche ne cherche pas à masquer les tensions, mais à les rendre discutables, en créant un espace neutre et sécurisé pour que salariés, managers et direction puissent exprimer ce qui, dans l’organisation, génère de l’appréhension ou mal-être.
Elle permet d’identifier les causes structurelles des RPS : manque de communication, rigidité des process, injonctions contradictoires, etc.
Ainsi, la médiation organisationnelle n’est pas un “à-côté” des politiques de prévention, mais un maillon essentiel de la gestion des RPS.
De surcroît, ce type d’action renforce également la sécurité juridique de l’employeur :
- En cas de contentieux, pouvoir montrer une démarche de prévention documentée (médiation, formation, soutien) est un facteur de protection ;
- Cela peut atténuer la gravité d’une condamnation, voire l’éviter si la politique de prévention est crédible.
Un dirigeant qui souhaite améliorer la performance et l’image de son organisation en recueillera les bénéfices rapidement :
- Un environnement de travail sain, de la motivation et de la productivité ;
- Une marque employeur renforcée, attractivité, fidélisation des talents ;
- La réduction des coûts liés à la souffrance au travail : absentéisme, turnover, remplacements, erreurs, etc.
Une culture organisationnelle co-construite permet aux équipes de s’habituer à dialoguer, à remonter les problèmes, à proposer des améliorations.
De son côté, le dirigeant s’habitue à recevoir des feedbacks authentiques. Des managers mieux formés et plus conscients des attentes pilotent mieux leurs équipes.
Comment l’intégrer dans une démarche concrète ?
La médiation organisationnelle peut être intégrée dans la stratégie RH et managériale de plusieurs façons :
- Diagnostic initial : enquêtes anonymes, entretiens, cartographie des risques psychosociaux ;
- Formation des managers : apprendre à détecter les signaux faibles et adopter une posture plus ouverte au dialogue ;
- Espaces de parole : groupes d’expression, médiations collectives, possibilité pour les collaborateurs de solliciter un médiateur interne ou externe ;
- Intégration dans la gouvernance : charte interne, protocoles de médiation, indicateurs de suivi des RPS intégrés aux bilans sociaux ;
- Suivi et transparence : communication régulière sur les actions menées, ajustement continu des dispositifs en fonction des retours terrain.
En conclusion, la jurisprudence sociale renforce les obligations des employeurs sur le plan organisationnel, pas seulement sur les actes individuels.
La médiation organisationnelle apparaît comme un outil central pour répondre à ces obligations de façon proactive, et pas juste réactive.
Elle permet non seulement de limiter les risques juridiques et financiers, mais aussi d’améliorer le bien-être, la performance et l’attractivité de l’entreprise.
Pour une stratégie RH moderne, la politique de l’amiable intégrée à la gouvernance managériale n’est pas uniquement un “plus”, mais un élément essentiel.
Cécile Fray Charlot
ADGREDIOR